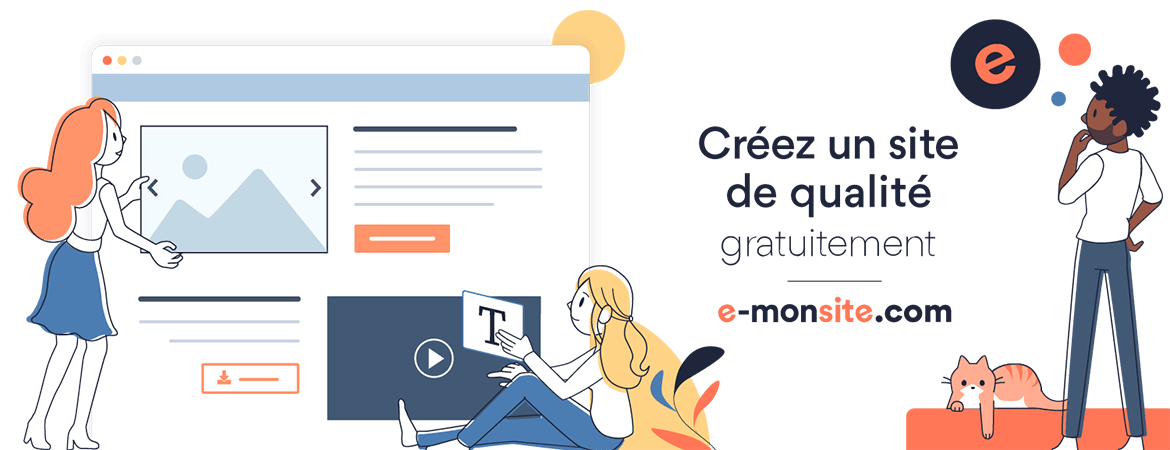La Défense nucléaire
La défense nucléaire de Jean KLEIN
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013
La mise en question de la dissuasion et les
perspectives d’un monde sans armes nucléaires
Jean Klein,
Professeur émérite de l’Université de Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne),
Alors que la stratégie de dissuasion nucléaire faisait l’objet d’un
consensus entre les grandes formations politiques depuis la fin des
années 1970 et que les sondages d’opinion révélaient une large
adhésion des Français à ce mode de prévention de la guerre
pendant la période de l’antagonisme Est-Ouest, on assiste depuis
l’effondrement de l’ordre bipolaire à une mise en question du rôle
des armes nucléaires dans l’organisation de la sécurité et de la
défense de notre continent. Ainsi on fait valoir que la menace
venant de l’Est s’est estompée et que l’affaiblissement des capacités
militaires de la Russie ne justifie plus le recours à l’arme nucléaire
pour compenser la supériorité dont jouissait le Pacte de Varsovie
dans le domaine des forces armées et des armements de type
classique. Par ailleurs, on laisse entendre que la force nucléaire
stratégique (FNS) serait à la fois inopérante pour conjurer les
nouveaux risques auxquels est exposé notre pays et inutile dans la
mesure où la menace d’une agression contre la France se serait
évanouie. Enfin, le maintien en état et le développement des
systèmes d’armes nucléaires détenus par les pays nantis inciteraient
ceux qui en sont dépourvus à se doter de capacités équivalentes et
contrediraient les engagements pris par les Etats parties au traité de
non prolifération (TNP) ouvert à la signature le 1er juillet 1968.
A partir de ces prémisses, les contestataires de la dissuasion
nucléaire prônent soit un désarmement unilatéral, soit la
participation active de la France à une négociation dont la visée
ultime serait l’élimination totale des arsenaux nucléaires. Précisons
que la mise en question de la dissuasion et l’aspiration à un monde
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
2
sans armes nucléaires n’est pas un phénomène propre à la France et
qu’à l’origine du mouvement dit « Global Zero » on trouve des
hommes politiques américains qui avaient adhéré sans états d’âme à
une stratégie de dissuasion fondée sur la « destruction mutuelle
assurée » et se montraient peu compréhensifs à l’égard des
« pacifistes nucléaires » dont les agissements étaient dénoncés
comme une atteinte aux intérêts de sécurité des Etats-Unis et de
leurs alliés. Il convient donc d’examiner les raisons qui les ont
incités à plaider aujourd’hui en faveur de l’élimination totale des
armes nucléaires et de s’interroger sur la pertinence des moyens
qu’ils proposent pour atteindre cet objectif. A cet égard, on ne peut
négliger les leçons de l’histoire et force est de constater que les
vicissitudes de la diplomatie du désarmement depuis la fin de la
seconde guerre mondiale n’inclinent pas à l’optimisme sur les
chances de voir s’instaurer un monde sans armes nucléaires dans
l’avenir prévisible.
Les illusions d’un désarmement général et complet.
La vision d’un monde sans armes nucléaires est ancienne et les
membres fondateurs des Nations Unies s’en sont inspirés pour
conjurer la menace que les armes atomiques faisaient peser sur
l’humanité après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki.
Ainsi, la première résolution de l’Assemblée générale de l’ONU,
adoptée le 24 janvier 1946, avait confié à une commission où
étaient représentés tous les Etats membres du Conseil de Sécurité le
soin d’élaborer des formules garantissant l’utilisation de l’atome à
des fins exclusivement pacifiques. Le plan Baruch proposé par les
Etats-Unis et leurs alliés était censé répondre à cette exigence
puisqu’il prévoyait de confier à un organe supranational - l’Atomic
Development Authority - la gestion directe de toutes les activités
nucléaires autorisées : extraction du minerai d’uranium, production
de matières fissiles, applications industrielles, expériences en
laboratoire, etc…Une fois ce dispositif mis en place, on aurait
procédé à la destruction des armes nucléaires dont les Etats-Unis
avaient alors le monopole.
On sait que ce projet se heurta d’emblée à l’opposition de l’Union
soviétique qui ne pouvait admettre qu’une agence supranationale
dominée par des Etats potentiellement hostiles exerce des
compétences aussi larges dans un domaine essentiel pour son
développement économique et sa sécurité. En outre, en souscrivant
au plan Baruch, elle aurait dû renoncer à mettre au point l’arme
nucléaire ce qui l’eût placée en position d’infériorité par rapport aux
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
3
Etats-Unis et pour gagner du temps elle répliqua par une
proposition tendant à l’interdiction d’emploi de l’arme atomique et
à la destruction préalable des stocks américains. Mais cette requête
était inacceptable par la partie occidentale car elle ne tenait pas
compte du rapport des forces qui s’était établi en Europe au
lendemain de la seconde guerre mondiale et se conciliait
difficilement avec le principe de la sécurité égale pour tous les Etats
participant au processus de désarmement. En effet, les Etats-Unis
avaient procédé à une démobilisation massive de leurs forces après
la chute du IIIème Reich et voyaient dans l’arme atomique un
moyen efficace pour contenir l’expansion du communisme à une
époque où les pratiques staliniennes avaient éveillé la méfiance des
Occidentaux sur les intentions pacifiques des dirigeants de Moscou.
Le rejet du plan Baruch en 1946 sonna le glas des espoirs que l’on
nourrissait en Occident sur les chances de l’instauration d’un
monde sans armes nucléaires. Au cours des décennies suivantes on
a assisté à l’élargissement du club nucléaire et à une course aux
armements qui s’est traduite par le perfectionnement incessant des
systèmes d’armes des deux protagonistes et l‘accumulation de
stocks gigantesques de charges nucléaires. Certes, des négociations
en vue de la limitation des forces armées et des armements se sont
poursuivies pendant cette période aussi bien dans le cadre de
conférences ad hoc que par le biais du dialogue stratégique soviétoaméricain,
mais elles n’ont produit que des résultats modestes et
n’ont pas mis un terme à la course quantitative et qualitative aux
armements les plus modernes.
Après la crise des fusées de Cuba en octobre 1962, qui avait failli
déboucher sur un affrontement direct entre les deux Grands, ceuxci
se soucieront moins de favoriser l’émergence d’un nouveau
système de sécurité collective par le biais du désarmement que
d’aménager le statu quo stratégique et de faire en sorte que
« l’équilibre de la terreur » qui s’était établi entre les deux camps de
la guerre froide ne soit pas rompu. A cet effet, l’accent était mis sur
des mesures tendant à contenir la prolifération des armes
nucléaires, à améliorer la communication entre adversaires en cas de
crise, à faire preuve de modération dans la compétition technostratégique
et à limiter les activités militaires dans des espaces ou
des zones géographiques déterminées. Cette nouvelle approche du
désarmement répondait à la logique de l’arms control (maîtrise des
armements), une doctrine élaborée aux Etats-Unis vers la fin des
années 1950 pour satisfaire aux exigences de la « coopérationDéfense
& Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
4
compétition » avec l’URSS. Elle inspirera la pratique diplomatique
des deux Grands jusqu’à la fin de l’antagonisme Est-Ouest.1
Au début des années 1960, on a donc abandonné la perspective
d’un « désarmement général et complet » qui était au coeur des
pourparlers amorcés en 1955 dans le cadre du sous-comité de la
commission du désarmement des Nations Unies. La philosophie à
laquelle on se référait alors était celle d’un désarmement général,
progressif, équilibré et contrôlé et la visée ultime était l’élimination
des armes de destruction massive et la réduction concomitante des
forces armées et des armements de type classique à des niveaux
compatibles avec le maintien de l’ordre intérieur et la mise en place
d’un système de sécurité collective. Il s’agissait là d’un objectif
ambitieux et on pouvait douter de la volonté des Etats engagés dans
la guerre froide de consentir aux sacrifices de souveraineté
nécessaires pour l’atteindre. En outre, les négociateurs se heurtèrent
très tôt à un obstacle de taille : le contrôle de l’élimination des
armes nucléaires. En effet, les techniques de détection dont on
disposait à l’époque ne permettaient pas de garantir que tous les
stocks d’armes nucléaires détenus par les trois puissances
homologuées - Etats-Unis, Royaume-Uni et Union soviétique –
seraient détruits en application d’un accord de désarmement et que
des tierces puissance ne parviendraient pas à se doter de la bombe
par des voies détournées. C’est en se fondant sur ce constat que les
Etats-Unis proposèrent de mettre en réserve tous les plans de
désarmement général jusqu’à ce que les progrès accomplis dans la
mise au point de techniques de vérification efficace permissent d’en
discuter utilement. En attendant, il fallait créer par des mesures de
confiance l’atmosphère propice à la conclusion d’accords limités
dans les domaines où le contrôle était techniquement possible et
politiquement acceptable.2
En dépit de la réduction du champ du désarmement à l’adoption de
mesures partielles, on a persisté à se référer au « désarmement
général et complet » dans les résolutions de l’Assemblée générale
des Nations Unies et dans des accords internationaux comme le
TNP. Mais en pratique, les plans de désarmement général et
1 Voir notre article : « La théorie et la pratique de l’arms control. Bilan et
Perspectives » in Etudes Internationales, Volume XX, N°3, septembre 1989
(Numéro spécial : « Les études stratégiques : où en sommes-nous ? »).
2 Sur la problématique de la réglementation internationale des armements
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nous renvoyons à notre
ouvrage : « Maîtrise des armements et désarmement. Les accords conclus
depuis 1945 » - Les études de La Documentation française, Paris, 1991.
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
5
complet ne font plus l’objet de négociations multilatérales depuis
1964 et les recommandations faites en 1978 pendant la session
extraordinaire de l’Assemblé générale des Nations Unies en vue de
l’élaboration d’un « plan global de désarmement » n’ont pas été
suivies d’effet faute d’un accord entre les principales puissances
militaires.3 Par ailleurs, la conférence du désarmement (CD) de
Genève, qui demeure le principal organe de négociation
multilatérale, est paralysée depuis 1996, faute d’un consensus entre
les 65 Etats participants sur un ordre du jour et un programme de
travail. Ainsi, du fait de l’opposition de l’Inde, le traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (TICE), n’avait pu être avalisé par le
CD et il n’a été ouvert à la signature qu’après avoir été adopté par
l’Assemblée générale de l’ONU, le 10 septembre 1996.4 Toutefois, il
n’est pas encore entré en vigueur, car les 44 Etats signataires dont la
ratification est requise pour lui faire produire effet n’ont pas tous
accompli cette formalité. Les Etats-Unis figurent dans ce nombre et
le Président Obama qui s’est illustré par l’évocation d’un « monde
sans armes nucléaires » dans son discours de Prague du 5 avril 2009,
n’a pas réussi jusqu’à présent à faire revenir le Sénat sur la décision
de rejet du TICE prise dix ans auparavant. Quant aux négociations
en vue de l’arrêt de la production de matières fissiles à des fins
militaires (FMCT ou Fissile material cut-off treaty) auxquels s’étaient
engagés les Etats parties au TNP à l’issue de la conférence
d’examen et de prorogation du traité en mai 1995, 5 elles sont
toujours dans les limbes. Comme les obstacles qui ont empêché la
conclusion d’un accord de désarmement général et complet dans le
passé ne seront pas levés de sitôt on ne laisse pas d’être surpris par
l’aplomb avec lequel les militants du « Global Zero » osent affirmer
3 Voir notre article : « L’ONU en quête d’un programme global de
désarmement » in « La crise du désarmement. La deuxième sessions
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement
(1982) », Arès, Défense et Sécurité, supplément. N°1/1983.
4 Voir « SIPRI Yearbook 1997. Armaments, Disarmament and International
Security» - pp. 403-431.
5 Aux termes du document sur « les principes et les objectifs de la nonprolifération
des armes nucléaires et du désarmement » adopté le 11 mai 1995,
les Etats parties au TNP s’engageaient dans un premier temps à « mener à bien
la négociation d’un traité d’interdiction complète des essais au plus tard en
1996 et à ouvrir des négociations immédiates et à conclure à brève échéance un
traité non discriminatoire et de protée universelle interdisant la production de
matières fissiles à des fis militaires ». En outre, les Etats dotés d’armes
nucléaires étaient invités à poursuivre avec détermination la réduction de leurs
arsenaux, le but ultime étant leur élimination et la conclusion d’un traité de
désarmement général et complet sous un contrôle international strict et
efficace » - Voir « SIPRI Yearbook 1996. Armaments, Disarmament and
International Security » pp.563-573, 590-593.
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
6
qu’un monde sans armes nucléaires a des chances de se réaliser à
l’horizon de 2030. 6
Les ambiguïtés du discours américain sur
l’élimination totale des armes nucléaires
L’évocation par les Quatre d’un monde sans armes nucléaires
L’idée d’un monde dont les armes nucléaires seraient bannies a été
lancée par quatre hommes politiques américains7 dans un article
célèbre paru le 4 janvier 2007 dans The Wall Street Journal sous le
titre « A world free of nuclear weapons ». A la différence des
promoteurs du mouvement « Global zero » créé l’année suivante, ils
se sont bien gardés de fixer une échéance pour la réalisation d’un tel
projet et ont mis l’accent sur l’adoption de mesures concrètes en
vue de consolider le régime de non prolifération. A leurs yeux, tout
devait être mis en oeuvre pour empêcher l’élargissement du club
nucléaire car la situation qui en résulterait serait moins stable que
celle qui prévalait pendant la période de la guerre froide. En outre,
il fallait conjurer le risque de l’accession à l’arme nucléaire
d’organisations terroristes qui n’hésiteraient pas à l’utiliser pour
réaliser leurs projets nihilistes. Toutefois, ils estimaient que des
mesures partielles de désarmement avaient peu de chances de rallier
les suffrages des Etats non dotés de l’arme nucléaire (ENDAN) si
elles ne s’inscrivaient pas dans la perspective de l’élimination totale
des arsenaux nucléaires prévue par l’article VI du TNP. Au cours de
la conférence d’examen du traité qui s’était tenue à New York, en
mai 2005, des controverses avaient surgi à ce propos entre les Etats
dotées de l’arme nucléaire et ceux qui en étaient dépourvus et la
conférence s’était achevée sans que l’on pût s’entendre sur un
document final abordant les questions de fond.8 Pour empêcher la
réédition de ces querelles lors de la conférence d’examen de 2010,
les quatre signataires de l’article du Wall Street Journal prenaient les
devants mais à leurs yeux l’évocation d’un monde sans armes
nucléaires avait surtout une valeur instrumentale au service d’une
stratégie pragmatique de lutte contre la prolifération. Ils ne se
6 L’échéance de 2030 pour l’abolition des armes nucléaires figure dans l’appel
lancé par les organisateurs de la conférence en faveur du « Global Zero » qui
s’est tenue à Paris du 2 au 4 février 2010.
7 Il s’agissait de George P. Shultz, Secrétaire d’Etat de 1982 à 1989, William J.
Perry, Secrétaire à la défense de 1994 à 1997, Henry A. Kissinger, Secrétaire
d’Etat de 1973 à 1977 et Sam Nunn, ancien président de la commission des
forces armées (Armed Services Committtee) du Sénat.
8 Voir « SIPRI Yearbook 2006 » pp. 608-618.
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
7
départiront pas de cette attitude dans les textes qu’ils publieront
ultérieurement dans le même organe de presse9 et dans leurs
interventions à la conférence sur la sécurité de Munich en 2009 et
201010.
Même si leurs détracteurs les accusent de nourrir des chimères en
prônant un monde sans armes nucléaires ou d’entretenir l’illusion
que la renonciation à l’arme nucléaire par les puissances nanties
dissuaderait les Etats dépourvus de s’en doter,11 on ne saurait leur
reprocher d’avoir sous-estimé le rôle dissuasif des armes nucléaires
pendant la phase transitoire qui précéderait leur abolition. A cet
égard, l’article publié dans The Wall Street Journal au début de l’année
2010 est sans équivoque. L’accent est mis sur la nécessité de
préserver la sûreté et la fiabilité des armes nucléaires détenues par
les Etats-Unis et d’affecter des ressources importantes au
financement des centres de production et des trois laboratoires de
recherche existants : Lawrence Livermore, Los Alamos et Sandia. A
leurs yeux, les efforts déployés par les ingénieurs et les scientifiques
qui se consacrent à la modernisation de l’arsenal nucléaire ne doit
pas se relâcher aussi longtemps que la sécurité de la nation l’exigera.
En outre, leur expertise est essentielle si l’on veut créer les
conditions favorables à l’instaurait d’un monde sans armes
nucléaires et garantir sa pérennité par des mesures de détection, de
vérification et de prévention efficaces. En définitive, il faut tenir les
deux bouts de la chaîne et faire en sorte que le maintien d’une
capacité de dissuasion crédible au service de la défense nationale
puisse se concilier avec une coopération internationale en vue de
réduire les risques du nouvel âge nucléaire.12
9 « Toward a nuclear-free world » et « How to protect our nuclear deterrence »
parus respectivement dans The Wall Street Journal, les 15 janvier 2008 et 19
janvier 2010.
10 Voir le compte-rendu de ces débats dans la revue mensuelle « Europäische
Sicherheit » N° 3/2009 et 3/2010.
11 Voir notamment l’article de Harold Brown et de John Deutch : « The nuclear
disarmament fantasy » in The Wall Street Journal du 19 novembre 2007. Harold
Brown était Secrétaire à la défense dans l’Administration Carter et John
Deutch, directeur de la Central Intelligence Agency dans la première
Administration Clinton. De son côté, Michael Rühle, le directeur du centre de
planification du Département politique de l’OTAN, a stigmatisé les
propositions des quatre qui ne feraient qu’entretenir de faux espoirs et
délégitimeraient la politique de sécurité des Occidentaux : « Eine Welt ohne
Nuklearwaffen ? Die Forderungen der Realisten sind unrealistisch » in Neue
Zürcher Zeitung, 5/6 juillet 2008.
12 « How to protect our nuclear deterrent », The Wall Street Journal, 19 janvier
2010.
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
8
Ainsi une lecture attentive des prises de position des quatre met
clairement en évidence le caractère pragmatique de leur démarche
et le peu de cas qu’ils font de sa visée ultime, à savoir l’élimination
totale des armes nucléaires. Dans son intervention du 6 février 2009
à la conférence sur la sécurité de Munich, Henry Kissinger
reconnaissait que lui-même et ses collègues étaient incapables
d’imaginer la forme que revêtirait un monde sans armes nucléaires
et qu’ils s’étaient attachés en priorité à l’élaboration de mesures
vérifiables et susceptibles d’application immédiate. Usant d’une
métaphore chère au sénateur Sam Nunn, il avait comparé leur
démarche à celle d’alpinistes qui ont entrepris l’escalade d’une
montagne dont le sommet est enveloppé de nuages et qui ignorent
les obstacles auxquels ils seront confrontés pour l’atteindre. Il se
pourrait que ceux-ci soient insurmontables, mais le seul moyen de
s’en assurer était de commencer l’ascension. De même, il fallait
amorcer le processus du désarmement par des mesures limitées
sans trop se soucier s’il aboutira ou non à l’élimination totale des
armes nucléaires.13
Le discours de Prague du Président Obama
Le discours prononcé par le Président Obama, à Prague, le 5 avril
2009, présente des similitudes avec les positions des quatre dans la
mesure où il affirme « la conviction que l’Amérique recherche la
paix et la sécurité dans un monde sans armes nucléaires » mais
concède que « ce but ne sera pas atteint rapidement et peut-être pas
de son vivant ». Comme eux il énonce des mesures concrètes qui
devraient favoriser la réalisation de ce programme et qui visent
aussi bien le désarmement et la maîtrise des armements que la lutte
contre la prolifération des armes nucléaires. Ainsi, le Président des
Etats-Unis préconise le renforcement des mécanismes chargés de
contrecarrer le trafic illicite des matières, équipements et
technologies susceptibles d’être utilisés pour la fabrication d’une
bombe, se prononce pour l’application de sanctions rigoureuses en
cas de non respect des obligations édictées par le TNP et appelle de
ses voeux l’organisation d’une coopération internationale
garantissant l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins
exclusivement pacifiques. Par ailleurs, il annonce la reprise des
négociations russo-américaines en vue d’une réduction des
armements stratégiques qui pourrait être une première étape sur la
voie d’un désarmement nucléaire auquel toutes les puissances
13 En l’occurrence, les quatre adhèrent à la maxime de Guillaume
d’Orange : « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour
persévérer ».
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
9
intéressées seraient associées ultérieurement. Enfin, il laisse
entendre que des dispositions seront prises pour réduire le rôle des
armes nucléaires dans la « stratégie de sécurité nationale » et qu’il
invitera les autres puissances à s’engager dans la même voie.
Toutefois, il met en garde ceux qui seraient enclins à interpréter
cette décision comme un geste de faiblesse et souligne que les
Etats-Unis maintiendront des capacités de dissuasion efficaces pour
tenir en échec tout adversaire direct et garantir la sécurité de leurs
alliés aussi longtemps que ces armes existeront.14
On conçoit que ce langage ait rassuré les dirigeants des pays alliés
qui ont salué le projet du Président américain même si certains
n’adhéraient que du bout des lèvres à sa vision d’un monde sans
armes nucléaires. Ainsi le Ministre français des affaires étrangères,
Bernard Kouchner, a déclaré que le discours de Prague comportait
des éléments positifs et que la France se tenait aux côtés des Etats-
Unis dans l’effort qu’ils entreprenaient en faveur du désarmement.15
Le Premier Ministre britannique, Gordon Brown, se montrait plus
enthousiaste et considérait qu’une réduction significative des armes
nucléaires mondiales pourrait intervenir à bref délai. Le Ministre
allemand des affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, ne
pouvait qu’applaudir dans la mesure où l’élimination des armes
nucléaires tactiques affectées à la défense du continent européen
répondait à l’attente de la majorité de ses concitoyens. Enfin, le
Ministre japonais des affaires étrangères, Hurofumi Nakasone,
appuyait fermement l’appel en faveur d’un monde sans armes
nucléaires et approuvait les mesures concrètes qui seraient prises à
cet effet.16
Dans le milieu des experts on prenait acte des engagements du
Président Obama tout en faisant observer que l’élimination des
armes nucléaires était une entreprise hasardeuse et qu’une réduction
drastique des arsenaux nucléaires pourrait avoir une incidence
négative sur la stabilité du régime de non-prolifération institué par
le TNP. Ainsi, Lawrence Freedman, professeur au King’s College
14 De larges extraits du discours de Prague ont été publiés dans la revue Arms
control today, Vol 39, N° 4, mai 2009.
15 A la Présidence de la République on avait des sentiments plus mitigés. Ainsi
Le Figaro du 10 avril 2009 fait état d’une note rédigée par la cellule
diplomatique de l’Elysée qui critiquait le discours de Prague et soulignait qu’en
matière de désarmement, la France n’avait pas de leçons à recevoir des Etats-
Unis.
16 Voir l’article de Cole Harvey : « Obama calls for nuclear weapons-free
world » - Arms control today, ibid
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
10
de Londres, estimait que la voie qui conduisait vers l’élimination des
armes nucléaires était semée d’embûches et que la passe la plus
dangereuse était celle qui précédait l’arrivée au but. C’est que la
réduction drastique des arsenaux des grandes puissances pourrait
affaiblir la crédibilité de la dissuasion élargie dont bénéficient leurs
alliés et partenaires. Lawrence Freedman n’en déduisait pas qu’il
fallait renoncer au désarmement mais attirait l’attention sur la
nécessité de garantir la sécurité de toutes les parties contractantes à
toutes les étapes du processus. Quant à l’élimination totale des
armes nucléaires elle soulevait des problèmes spécifiques dont la
solution n’était pas évidente et ne produirait pas nécessairement les
effets bénéfiques escomptés car l’histoire enseigne qu’il n’y a jamais
eu de « relation naturelle entre la paix et la diminution des niveaux
d’armement ».17
De son côté, Michael Rühle soulignait le contraste entre le discours
dithyrambique du président américain et les réalités d’un monde où
les puissances nucléaires continuaient de moderniser leurs arsenaux
et où les candidats à l’arme nouvelle poursuivaient leur dessein sous
le couvert de l’utilisation pacifique de l’atome. Ainsi le Président
Ahmadinejad saluait la vision d’un monde sans armes nucléaires
alors que l’Iran continuait d’enrichir de l’uranium et de se
rapprocher du seuil nucléaire. Par ailleurs, la Corée du Nord avait
procédé à l’essai d’un missile balistique quelques heures avant le
discours de Prague et ce défi à l’ordre international n’avait pu être
relevé, la Chine et la Russie s’étant opposés à l’adoption de
nouvelles sanctions par le Conseil de Sécurité. Le rêve d’un monde
sans armes nucléaires avait donc peu de chances de se réaliser et M.
Rühle retenait surtout du discours du Président Obama
l’affirmation selon laquelle les Etats-Unis resteraient une puissance
nucléaire aussi longtemps que d’autres détiendraient cette arme.18
Enfin, l’incidence du désarmement nucléaire sur les équilibres
stratégiques en Asie a également été examinée à l’occasion d’un
dialogue américano-japonais organisé par le Pacific Forum peu
17 « This new nuclear arms age has its own set of risks » par Lawrence
Freedman - Financial Times, 9 avril 2009.
18 Voir ses articles : « Nette Idee, schöner Traum. Eine Welt ohne
Atomwaffen ? Obamas Vorschläge klingen gut, werden aber kaum umgesetzt
können » in Suddeutsche Zeitung, 11 avril 2009 et « Kontinuität in der
americkanischen Nuklearstrategie » in Politische Studien, N° 427, septembreoctobre
2009
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
11
avant le discours de Prague.19 Il en ressort que, contrairement à une
idée reçue, les Japonais n’applaudiraient pas nécessairement à une
réduction drastique des capacités nucléaires russes et américaines si
celle-ci devait se traduire par un affaiblissement de leur sécurité face
à la Chine. A leurs yeux, le désarmement n’avait de sens que si
toutes les puissances nucléaires y participaient et acceptaient des
réductions équivalentes à celles des deux protagonistes. En
attendant, ils émettaient le voeu que les Etats-Unis informent leurs
alliés asiatiques - le Japon et la Corée du Sud - de leurs intentions en
la matière et les associent à l’élaboration de leur stratégie nucléaire
(Nuclear posture review) afin de dissiper tout malentendu sur la
pérennité de la garantie qui leur était offerte.
La contestation de la dissuasion sous la présidence de
Nicolas Sarkozy
Si l’on fait abstraction des prises de position d’organes et de
mouvements d’Eglise tels que la commission Justice et Paix et la
section française de Pax Christi20 et des actions menées par le parti
Europe Ecologie/Les Verts, la revendication d’un monde sans
armes nucléaires ne concerne qu’une fraction restreinte de l’opinion
française. Toutefois, des hommes politiques qui avaient exercé des
responsabilités gouvernementales dans le passé ont pris leurs
distances par rapport à la stratégie de dissuasion de la France et ont
épousé les thèses défendues par le mouvement dit Global Zero.
Ainsi, Michel Rocard qui participa naguère aux travaux de la
commission de Canberra sur l’élimination des armes nucléaires et
préfaça l’édition française du rapport qu’elle avait adopté en 1996,21
s’est prononcé à plusieurs reprises dans les médias pour l’abandon
de la force nucléaire stratégique (FNS) mais il s’est toujours heurté à
une opposition ferme des dirigeants français qui n’hésitaient pas à
qualifier ses initiatives d’irresponsables. Paul Quilès a lui aussi
répudié la politique dont il avait la charge lorsqu’il exerçait les
fonctions de Ministre de la Défense (1985-1986) et aujourd’hui il
19 Voir l’article de Raph A Cossa : « Global nuclear disarmament : too much,
too soon ? » - PacNet Newsletter, 17 avril 2009. L’auteur est le président du
Pacific Forum CSIS.
20 Un ouvrage qui fait le point de la réflexion catholique sur ce sujet vient de
paraître sous les auspices de l’Institut catholique de Paris, de la commission
Justice et Paix et de la section française du Mouvement Pax Christi : « La paix
sans la bombe ? Organiser le désarmement nucléaire » - Paris, Les Editions de
l’Atelier/Editions ouvrières, 2014
21 Voir « Rapport de la commission Canberra. Eliminer les armes nucléaires » -
Introduction de Michel Rocard – Paris, Editions Odile Jacob, 1997.
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
12
milite activement en faveur du désarmement nucléaire en liaison
avec le mouvement Global Zero, l’organisation des maires pour la
paix et le réseau des parlementaires pour la non-prolifération
nucléaire et le désarmement. Il a publié en 2012 un recueil de textes
qui plaident en faveur de l’abandon de la force nucléaire stratégique
et dénoncent le « mensonge français » d’une sécurité fondée sur la
dissuasion.22 Toutefois, il se garde bien d’aborder les problèmes que
soulève l’organisation de la sécurité dans un monde sans armes
nucléaires et ne précise pas les modalités du désarmement auquel la
France devrait se prêter. Renoncerait-elle unilatéralement à ses
capacités nucléaires pour inciter les autres à suivre son exemple ou
réduirait-elle progressivement son arsenal en application d’accords
de désarmement négociés dans un cadre multilatéral ? Ces questions
sont cruciales mais Paul Quilès les laisse sans réponse et préfère se
livrer à des incantations sur la nécessité et la faisabilité de
l’élimination totale des armes nucléaires sans avancer des arguments
solides à l’appui de sa thèse.
L’année suivante il a donné une forme plus ample à son plaidoyer
dans un livre publié en collaboration avec Bernard Norlain et Jean-
Marie Collin.23 Ses aperçus sur les « angles morts » de la dissuasion
et sur les risques de conflit dans un monde où les détenteurs de
l’arme nucléaire se sont multipliés et où des organisations terroristes
pourraient se doter de la bombe méritent d’être pris en
considération dans le débat en cours. Toutefois, on ne peut qu’être
indisposé par les jugements abrupts, voire téméraires qu’il porte sur
la politique de défense de la France et sur la compétence des
stratégistes qui ont posé ses fondations théoriques. Quant au
désarmement, dont le succès conditionne l’avènement d’un monde
sans armes nucléaires, il ne fait pas l’objet d’une analyse rigoureuse
et les 13 pages qui lui sont consacrées se bornent à paraphraser le
plan d’action de Global Zero en passant sous silence les difficultés
auxquelles se heurterait sa réalisation.24
22 Paul Quilès : « Nucléaire, un mensonge français. Réflexions sur le désarmement
nucléaire » - Paris, Editons Charles Léopold Mayer, 2012
23 Paul Quilès avec Bernard Norlain et Jean-Marie Collin : « Arrêtez la bombe ! » -
Paris, Editions le Cherche Midi, 2013. Bernard Norlain est général d’armée
aérienne (2S) et Jean-Marie Collin est le directeur pour la France du réseau
international des parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le
désarmement.
24 Les chapitres 8 et 9 évoquent respectivement « les difficultés du
désarmement » et « les voies possibles » (pp. 153-16). Le plan d’action de
Global Zero figure en annexe de l’ouvrage (pp.235-236)
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
13
D’autres personnalités politiques et militaires sont intervenues dans
ce débat et ont mis en question la stratégie de dissuasion de la
France en se référant implicitement à la philosophie dont se
réclame le mouvement Global Zero.25 Certes, le souci de se
conformer à l’esprit du temps a pu les inciter à faire écho à des
thèses soutenues par des stratégistes et des décideurs d’outre
Atlantique qu’on ne pouvait soupçonner d’avoir négligé les intérêts
de sécurité de leur pays lorsqu’ils participaient à l’exercice du
pouvoir. En outre, ils précisaient qu’en adhérant à la vision d’un
monde sans armes nucléaires, ils n’envisageaient pas de priver la
France des capacités dont elle s’était dotée pour faire face à toute
éventualité et notamment à une menace contre ses intérêts vitaux.
A leurs yeux, l’objectif ambitieux qu’ils s’étaient assignés ne pouvait
être atteint que par un désarmement progressif et équilibré et ils
reprochaient surtout au gouvernement de ne pas vouloir s’engager
dans cette voie sous prétexte que l’élimination des armes nucléaires
relevait de l’utopie.
Or la France avait démontré depuis la fin de la « guerre froide » son
attachement à la réglementation internationale des armements en
adhérant au traité d’interdiction totale des essais nucléaires (TICE)
et en réduisant le format de sa force nucléaire. En outre, le
Président de la République, Nicolas Sarkozy, avait exposé ses vues
sur la stratégie de dissuasion dans un discours prononcé à
Cherbourg, le 21 mars 2008, à l’occasion de la présentation du sousmarin
nucléaire lance engins (SNLE), « Le Terrible » et fait des
propositions en vue de relancer les négociations en vue du
désarmement.26 Ces propositions furent avalisées par le Conseil de
l’Union européenne, le 8 décembre 2008, et transmises au Secrétaire
général de l’ONU au moment où se tenait dans un hôtel parisien la
conférence inaugurale du Mouvement « Global Zero ».27 Certes, le
chef de l’Etat n’avait pas l’intention de renoncer à la dissuasion
25 Le texte le plus significatif à cet égard est la tribune libre parue dans Le Monde
du 15 octobre 2009 sous le titre : « Pour un désarmement nucléaire mondial,
seule réponse à la prolifération anarchique ». Elle était signée par Alain Juppé,
ancien Premier Ministre ; Bernard Norlain, général, ancien commandant de la
force aérienne de combat ; Alain Richard, ancien Ministre de la défense ;
Michel Rocard, ancien Premier Ministre.
26 Voir sur le site de l’Elysée : « Discours de M. le Président de la République.
Présentation du SNLE, Le Terrible. Cherbourg, vendredi 21 mars 2008 ».
27 Voir la « Déclaration sur le renforcement de la sécurité internationale »,
Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 11 décembre 2008 et les
commentaires parus respectivement dans Le Figaro du 8 décembre : « Sarkozy
veut relancer le désarmement nucléaire » et Le Monde du 10 décembre : « Le
désarmement nucléaire au coeur du débat transatlantique ».
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
14
qualifiée d’ « assurance vie de la nation » et se montrait sceptique
sur la valeur opératoire de l’« option zero » pour lutter contre la
prolifération. Mais il pouvait se prévaloir en matière de
désarmement d’initiatives qui témoignaient de sa volonté
d’accompagner la nouvelle politique annoncée par l’Administration
Obama. On peut donc s’interroger sur les raisons qui ont conduit
des membres de l’establishment politique et militaire français à
privilégier les thèses du Mouvement Global zero alors que le
discours américain auquel il faisait écho était ambivalent et que les
dissension apparues lors de la conférence de Paris de février 2010
ont sérieusement écorné son image.
Le Mouvement dit « Global Zero »
Le mouvement Global Zero a été créé en 2008 à l’initiative d’une
centaine de personnalités du monde politique et militaire, d’experts
des questions de sécurité et de représentants de la « société civile ».
L’objectif poursuivi était l’élimination des armes nucléaires par un
accord en bonne et due forme et la mise en place d’un système de
vérification adéquat. Le processus serait amorcé par une réduction
significative des arsenaux russes et américains qui représentaient
96% des charges nucléaires disséminées à travers le monde.
Ultérieurement, les autres puissances nucléaires s’imposeraient des
contraintes équivalentes en application d’accords négociés dans un
cadre multilatéral et l’on s’acheminerait ainsi par étapes vers un
monde sans armes nucléaires. Enfin, la gestion internationale du
cycle du combustible nucléaire empêcherait le détournement des
activités nucléaires pacifiques à des fins militaires. Dans un appel
adopté le 17 octobre, les membres fondateurs avaient établi une
feuille de route et prévu que le but pourrait être atteint en 2020.
Une conférence au sommet devait se réunir au début de l’année
2010 pour entériner les conclusions d’une commission russoaméricaine
chargée d’établir un partenariat pour l’élimination des
armes nucléaires et mobiliser l’opinion publique au service de cette
cause.
Cette conférence s’est tenue à Paris du 2 au 4 février 2010 et elle a
bénéficié d’une large couverture médiatique en raison de l’actualité
de la question débattue, de la notoriété des principaux participants
et de la caution que lui apportèrent les Présidents russe et
américain, le Premier Ministre britannique et le Secrétaire général de
l’ONU. Toutefois, les messages de soutien adressés à la conférence
n’avaient pas tous la même tonalité. Ainsi, les Présidents Obama et
Medvedev, tout en adhérant à l’idée d’un monde sans armes
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
15
nucléaires, faisaient état des obstacles à surmonter et des conditions
à remplir pour assurer le succès de l’entreprise tandis que M. Ban
Ki-moon mettait l’accent sur la nécessité de parvenir à un
désarmement nucléaire mondial et considérait que global zero
n’était pas seulement un slogan mais un objectif tangible. Quant à
M. Gordon Brown, il se montrait optimiste sur les chances de
l’élimination des armes nucléaires tout en admettant que le chemin
à parcourir serait long et périlleux.
Ces propos bienveillants, sinon complaisants à l’adresse des
organisateurs de la conférence de Paris n’ont pas empêché les
débats de prendre dès le début un tour polémique. Les principaux
points de divergence portaient sur le sort réservé aux armes
nucléaires tactiques (ANT) dans les négociations sur le
désarmement et sur la politique à suivre pour empêcher la
dissémination des armes nucléaires au Moyen-Orient.
Dans son intervention du 2 février, le Ministre des Affaires
étrangères de la Suède, Carl Bildt, avait pressé la Russie et les Etats-
Unis de réduire substantiellement leurs stocks d’ANT en Europe et
plus particulièrement celles déployées aux confins orientaux de
l’Union Européenne (UE). Cette exhortation suscita une réplique
vigoureuse de l’ancien Secrétaire d’Etat, George Shultz, qui mit en
cause la politique de la Russie à laquelle il reprochait d’accroître son
stock d’armes nucléaires tactiques28 et d’envisager leur emploi sur
les champs de bataille. Le sénateur russe, Mikhail
Margelov, contesta la véracité des allégations américaines et assura
que son pays était prêt à réduire les stocks existants après la
conclusion d’un nouvel accord sur la réduction des armements
stratégiques. Par delà cette querelle, il convient de rappeler que les
ANT n’ont pas été prises en compte jusqu’à présent dans le cadre
des négociations dites START et que leur réduction n’est
concevable que si l’on corrige simultanément les déséquilibres au
plan des forces armées conventionnelles. 29
Par ailleurs, le programme nucléaire iranien a fait l’objet d’une
controverse à la suite d’une déclaration de George Shultz qui
28 Au cours du débat suscité par l’intervention de Carl Bildt, Richard Burt, un
diplomate qui avait participé aux négociations sur la maîtrise des armements
sous l’Administration Reagan avait indiqué que la Russie disposait d’au moins
7000 ANT alors que les Etats-Unis n’en avaient déployé qu’une centaine en
Europe.
29 Voir l’article de David Gardner : « Nuclear stars move towards benign
alignement » - Financial Times, 4 février 2010
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
16
contestait la légitimité de l’enrichissement de l’uranium par Téhéran
au motif que le pays possédait en abondance du gaz et du pétrole et
pouvait se passer de la filière nucléaire pour satisfaire ses besoins
énergétiques. La reine Noor de Jordanie s’est insurgée contre ce
propos et a fait observer qu’on ne pouvait imposer des sanctions à
l’Iran, tout en ignorant les capacités militaires d’autres nations. A
ses yeux, tous les Etats de la région devaient être traités sur un pied
d’égalité. Comme l’Etat d’Israël était visé en l’occurrence, George
Shultz prit son parti et fit valoir qu’il ne pouvait se défaire de son
armement puisqu’il était entouré d’ennemis qui contestaient son
droit à l’existence. En revanche, les ambitions nucléaires de l’Iran
devaient être contenues à tout prix et si les sanctions étaient
inopérantes on aurait recours à d’autres moyens pour l’amener à
résipiscence.
Ce désaccord ne pouvait que faire naître des doutes sur les chances
de réalisation du programme global zero puisque dans un domaine
aussi crucial que celui de la lutte contre la prolifération les positions
de l’ancien Secrétaire d’Etat américain et de la reine de Jordanie
étaient aux antipodes. En tout cas ce n’est pas en mettant en cause
le « droit inaliénable de toutes les parties au TNP d’utiliser l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques » (article IV) qu’on pouvait espérer
consolider le régime de non prolifération et le « deux poids, deux
mesures » dans l’évaluation des capacités nucléaires des Etats de la
région rendait improbable la création d’une zone exempte d’armes
nucléaires (ZEAN) dont le principe avait été approuvé par la
conférence d’examen et de prorogation du TNP en 1995.
S’agissant de la possibilité de parvenir à l’élimination totale des
armes nucléaires en l’espace de vingt ans, les illusion que l’on
pouvait nourrir à cet égard se sont dissipés après l’intervention de
Mme Ellen Tauscher, sous-secrétaire d’Etat pour la maîtrise des
armements et la sécurité internationale et l’interview accordée à
l’Agence Interfax par le Président de la commission des affaires
internationales de la Douma, M Konstantin Kosachyov. En
exposant, le 3 février, la position du gouvernement américain, Mme
Tauscher a salué la vision du Président Obama d’un monde sans
armes nucléaires mais elle n’a pas dissimulé que la réalisation de ce
projet était une entreprise de longue haleine et que le but ne serait
sans doute pas atteint dans les délais prévus par le mouvement
global zero. Comparant le désarmement nucléaire avec le Graal, elle
estimait que sa quête n’avait de sens que si elle contribuait au
renforcement de « notre sécurité nationale ». Aussi les étapes à
franchir pour atteindre l’objectif final devaient-elles davantage
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
17
retenir l’attention que le but que l’on s’était assigné. Ce qui
importait en définitive était l’adoption de mesures concrètes
susceptibles de renforcer la sécurité des Etats et de contribuer à la
stabilité de l’ordre international.
De son côté, M. Konstantin Kosachyov, a exprimé des réserves sur
les perspectives ouvertes par la conférence de Paris et estimé que si
l’élimination des armes nucléaires était une idée séduisante, elle
avait peu de chances de se concrétiser à moyen terme. Selon lui, le
plan d’action en quatre étapes adopté à l’issue de la conférence
n’était pas réaliste car il ne pouvait pas être appliqué d’une manière
satisfaisante avant l’échéance fixée en 2030. Par ailleurs, M.
Kosachyov rejoignait les préoccupations de Mme Tauscher en
affirmant que le désarmement n’était pas une fin en soi et qu’il
fallait le juger en fonction de sa contribution au renforcement de la
sécurité internationale. Or la Russie était particulièrement sensible à
cet aspect du problème et redoutait que des décisions hâtives en
matière de désarmement pourraient modifier l’équilibre des forces à
son détriment, « en raison de son infériorité au plan des forces
conventionnelles, de la militarisation de l’espace et de l’existence de
mécanismes de sécurité collective tels que l’OTAN ».30
De prime abord, la position de la France n’était pas facile à
défendre dans cette enceinte car ses dirigeants ne faisaient pas
mystère des réserves que leur inspirait le programme global zero. A
leurs yeux la dissuasion nucléaire conservait sa validité dans un
contexte stratégique mondial lourd d’incertitude.31 En outre, Paris
contestait l’idée selon laquelle la réduction des arsenaux des grandes
puissances entraînerait le ralentissement des programmes nucléaires
des autres pays. Enfin, l’abolition des armes nucléaires apparaissait
dans la meilleure des hypothèses comme un objectif lointain et il
était préférable de faire porter l’effort sur la négociation de mesures
concrètes qui avaient des chances d’être appliquées à court ou à
moyen terme. C’est dans cet esprit que le Secrétaire général du Quai
d’Orsay, M. Pierre Sellal, s’est exprimé le 2 février devant les
participants de la conférence.
30 « Global Zero deserves attention but must not be overestimated » - Interfax, 4
février 2010
31 Selon Le Figaro du 3 février 2010, un diplomate français aurait fait ce
commentaire en marge de la conférence : « Le rêve de vivre dans un monde
sans armes, un monde angélique, est un rêve que l’humanité poursuit depuis
toujours et que l’on ne peut qu’applaudir. Se passer de l’arme nucléaire alors
qu’elle existe toujours dans la panoplie et que d’autres pays la possèdent me
paraît en revanche risqué »
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
18
Selon lui, la priorité devait être accordé à la recherche d’une
solution diplomatique au problème iranien car si l’Iran accédait à
l’arme nucléaire il en résulterait « une cascade de prolifération dans
la région et une anarchie nucléaire dans le monde, qui mettra fin au
rêve d’un monde dénucléarisé ». Soulignant ensuite l’écart entre la
rhétorique du désarmement et sa mise en oeuvre, il affirma que les
« vraies mesures de désarmement sont basées sur des faits et pas
seulement sur des paroles ». Or la réalité était décevante puisque les
négociations START avaient été interrompues et que les Russes et
les Américains venaient seulement de s’entendre sur le principe de
leur reprise. Par ailleurs, le TICE n’était toujours pas entré en
vigueur et la paralysie de la conférence de Genève sur le
désarmement rendait problématique la conclusion à bref délai d’un
traité sur l’arrêt de la production de matières fissiles à des fins
militaires. La France, quant à elle, avait donné l’exemple en matière
de désarmement nucléaire en renonçant à la composante terrestre
de la FNS, en diminuant d’un tiers sa composante aéroportée, en
réduisant le nombre de ses têtes nucléaires et en démantelant ses
centres d’essais nucléaires. Il appartenait donc aux autres puissances
nucléaires de s’engager dans la même voie et de réduire leurs
arsenaux pour « arriver à la stricte suffisance ». Quant à
l’élimination totale des armes nucléaires elle aura lieu quand « les
conditions de sécurité et politiques seront réunies ».
Ce discours a pu décontenancer l’auditoire auquel il s’adressait et
susciter des réactions négatives de la part des ténors du
mouvement. Ainsi Richard Burt, a manifesté son dépit en déclarant
que « la position française était davantage déterminée par des
« réflexes émotionnels et psychologiques hérités de la tradition
gaullienne que par la défense des intérêts nationaux ». Toutefois il
estimait qu’elle pourrait « évoluer dans le temps, si nous trouvons le
moyen de multilatéraliser l’effort en ralliant les Russes et les
Chinois ».32 Il excluait en tout cas l’éventualité du ralliement de la
France à un programme auquel la Russie n’adhérait que du bout des
lèvres. Par ailleurs, des voix se sont élevées en marge de la
conférence de Paris pour critiquer la politique américaine et
souligner le contraste entre un discours irénique prônant
l’élimination totale des armes nucléaires et une pratique tendant à
32 Voir les articles consacrés à la conférence global zero de Paris par Isabelle
Lasserre : « Désarmement nucléaire : Paris résiste à l’option zéro » - Le Figaro, 3
février 2010 et Natalie Nougayrède : « Paris réticent face à l’élimination de
l’arme nucléaire » - Le Monde, 3 février 2010
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
19
augmenter les crédits affectés à leur modernisation.33 A cet égard,
l’appréciation formulée par Leo Michel, professeur à la National
Defense University de Washington, lors d’un débat organisé par à la
Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS) était
particulièrement topique : « Pour Barack Obama, un monde
dénucléarisé n’est qu’une vision à long terme. En face il y a la
réalité, la nécessité de rassurer nos alliés et de maintenir pour
l’instant une dissuasion efficace ».34
En définitive, la position de la France telle qu’elle a été exposée par
le Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères pouvait
difficilement être récusée par le mouvement global zero dès lors
que les porte-parole des Etats-Unis et de la Russie étalaient leurs
divergences à la conférence de Paris et exprimaient des doutes sur
la possibilité de parvenir à l’élimination totale des armes nucléaires.
En outre, l’approche pragmatique préconisée par la France ne se
distinguait pas fondamentalement de celle des deux grandes
puissances nucléaires qui mettaient elles aussi l’accent sur l’adoption
de mesures concrètes en vue de progresser sur la voie du
désarmement sans trop se soucier de la manière dont l’objectif final
pourrait être atteint. En revanche, le gouvernement français estimait
que ce n’est pas en faisant miroiter aux yeux de l’opinion publique
l’utopie d’un monde sans armes nucléaires que l’on servait la cause
du désarmement mais en abordant de front les problèmes qu’il
soulève et en tentant de les résoudre en veillant à ce que la
réductions des forces armées et des armements soit progressive et
équilibrée et qu’à chaque étape du processus la sécurité de toutes les
parties contractantes soit garantie. Or l’expérience a démontré
qu’on ne peut pas déterminer à l’avance la durée des négociations
nécessaires pour parvenir à un accord et qu’il est téméraire
d’envisager l’élimination totale des armes nucléaires à l’horizon
2030. En fixant cette échéance le mouvement global zero a fait un
pari audacieux qui a peu de chances d’être gagné et la crédibilité de
son action risque d’en pâtir durablement.
33 Voir notamment l’article de Greg Mello : « The Obama disarmament
paradox » - Bulletin of the Atomic Scientists , 4 février 2010.
34 Voir l’article de Isabelle Lasserre : « Désarmement nucléaire : l’objectif 2030
de Global Zero » - Le Figaro, 5 février 2010
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
20
Le débat sur la dissuasion après l’accession de la
gauche au pouvoir
Après les élections présidentielles et législatives du printemps 2012
et l’accession de la gauche au pouvoir, le gouvernement socialiste a
maintenu la continuité de la politique de sécurité et de défense de la
France et a réaffirmé son attachement à la dissuasion nucléaire. A
cet égard, le geste du Président de la République d’effectuer, le 4
juillet, une plongée à bord du SNLE, « Le Terrible », au large de
Brest a revêtu une valeur symbolique très forte. Peu avant, il avait
désavoué Michel Rocard qui avait déclaré sur la chaîne de télévision
BFMTV, le 19 juin, que « la suppression de la force de dissuasion
permettrait d’économiser par an 16 milliards d’euros qui ne servent
absolument à rien ». Dans une déclaration faite le lendemain en
marge de la conférence de Rio sur la terre, François Hollande fit la
mise au point suivante : « Renoncer à la dissuasion nucléaire pour
des raisons d’économie budgétaire n’est pas aujourd’hui la position
de la France. Je me suis engagé devant les Français pour préserver
la dissuasion nucléaire parce que c’est un élément qui contribue à la
paix. Il y a des négociations et une discussion sur le désarmement
nucléaire. La France doit y prendre toute sa part et nous le
ferons »35 Cette ligne était confirmée l’année suivante par l’adoption
d’un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale préfacé par le
Président de la République.36 Il y énonçait les trois priorités de la
stratégie française – la protection, la dissuasion et l’intervention - et
soulignait leur interdépendance.
S’agissant de la dissuasion nucléaire, le Livre Blanc ne laisse planer
aucun doute sur la volonté du gouvernement de persévérer dans la
voie où la France s’était engagée sous la présidence du général de
Gaulle. On y proclame la nécessité de détenir une force nucléaire
pour « empêcher toute agression contre le territoire national » et
écarter toute menace de chantage que « certaines puissances
nucléaires de droit ou de fait pourraient être tentées d’exercer en
cas de crise internationale contre nous et nos alliés ». En outre, la
France, qui a réintégré les structures du commandement militaire de
l’OTAN, se doit de respecter les engagements énoncés dans le
concept stratégique adopté en novembre 2010 à Lisbonne. Celui-ci
réaffirme « le rôle des armes nucléaires en tant que garantie
35 Voir les commentaires de Jean Guisnel : « Dissuasion : Michel Rocard remet
les pieds dans le plat » - Le Point, 21 juin 2012 et de Nathalie Guibert : « En
France, la rigueur rouvre le débat sur la dissuasion » - Le Monde, 23 juin 2012
36« Livre Blanc. Défense et Sécurité nationale 2013 » - Paris, La Documentation
française, mai 2013
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
21
suprême de la sécurité et pilier de la doctrine de défense de
l’alliance » et rappelle qu’aux termes de la déclaration d’Ottawa du
19 juin 1974 les « forces nucléaires françaises et britanniques jouent
un rôle dissuasif propre contribuant au renforcement global de la
dissuasion de l’alliance ». Enfin, un lien étroit est établi entre la
dissuasion nucléaire et la capacité d’intervention sur des théâtres
extérieurs : une force de dissuasion qui ne prendrait pas appui sur
des forces conventionnelles perdrait de sa crédibilité puisque la
France ne serait plus en mesure de « défendre ses intérêts
stratégiques et d’honorer ses alliances ». On conçoit que cette
réaffirmation de la doctrine traditionnelle ait ravivé la flamme des
opposants à l’arme nucléaire mais on observe également un
élargissement du débat sur la dissuasion et une diversification des
arguments mis en avant par ceux qui en contestent la pertinence ou
préconisent son adaptation au nouveau contexte international.
L’ancien Ministre de la défense, Paul Quilès, et le général Bernard
Norlain, ont réagi avec véhémence en déplorant le « conformisme
et l’archaïsme intellectuel » des déclarations officielles et en
regrettant que la France se tienne à l’écart du « mouvement de
dénucléarisation générale ». Toutefois, le général Norlain ne
dissimule pas son désenchantement et laisse entendre que l’agitation
entretenue par le mouvement global zero pourrait être vaine
puisque toutes les puissances nucléaires continuent de moderniser
leurs arsenaux et que les Etats-Unis ne font pas exception à la règle.
En outre, il prend acte du fait que sa voix est isolée au sein de la
corporation des officiers qui n’osent pas mettre en question le
dogme de la dissuasion et ne perçoivent pas la signification du
désarmement dans la perspective de la lutte contre la prolifération.
Enfin, pour dissiper tout malentendu, il s’inscrit en faux contre des
mesures unilatérales et précise que l’élimination totale des armes
nucléaires interviendrait dans le cadre d’un « traité de désarmement
général et complet sous un contrôle international strict et
efficace ».37
L’ancien Ministre de la Défense, Hervé Morin, s’est prononcé lui en
faveur d’une réduction du format de la force nucléaire stratégique et
a proposé de l’amputer de sa composante aéro-terrestre, la nécessité
de délivrer un ultime avertissement à l’adversaire ne s’imposant plus
dans le nouveau contexte stratégique. Il ne conteste pas la fonction
37 Voir l’interview du général Bernard Norlain par Jean Guisnel - Le Point, 15
juillet 2012. Dans une tribune libre parue dans Le Monde du 29 octobre 2011, le
général Norlain s’était exprimé d’une manière plus abrupte : « L’arme nucléaire
est inutile et coûteuse. Se débarrasser d’un danger pour la planète »
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
22
dissuasive de l’arme nucléaire mais estime que la force océanique
stratégique (FOST) est suffisante pour répondre aux besoins de la
dissuasion « tant qu’il y aura des menaces potentielles pour notre
sécurité ultime ».38 Par ailleurs, l’abandon de la « deuxième
composante » de la force nucléaire permettrait de réaliser des
économies qui pourraient être affectées au renforcement des forces
conventionnelles et contribueraient ainsi au maintien de l’équilibre
d’ensemble sur lequel repose la politique de défense et de sécurité
de la France. Hervé Morin se soucie également de la place du
désarmement dans la lutte contre la prolifération, celle-ci ne
pouvant être enrayée que si les puissances dotées de l’arme
nucléaire engagent une « marche collective vers son bannissement ».
Il appartient aux Russes et aux Américains de faire les premiers pas
dans cette direction mais les autres puissances nucléaires devront se
joindre à eux lorsque les conditions de leur participation à une
négociation multilatérale seront réunies.39
Quant aux prises de position du général Vincent Desportes sur la
stratégie de dissuasion, elles reflètent les préoccupations de l’armée
de terre qui craint que les restrictions budgétaires se traduisent par
un affaiblissement des forces conventionnelles. A ses yeux, la
« sanctuarisation des crédits nucléaires » risque de porter un coup
fatal aux forces de projection qui permettent à la France « d’agir
d’une manière autonome dans l’espace géographique qui
correspond à ses intérêts sécuritaires, l’Europe, le bassin
méditerranéen et l’Afrique jusqu’u golfe de Guinée ». Faute de
maintenir cette capacité, la France serait réduite à ne mener dans la
durée que « des opérations dont les Etats-Unis valideraient le
principe » et condamnée à ne fournir qu’une « force d’appoint au
sein d’une coalition ».40 Il faudrait donc redimensionner l’arsenal
nucléaire et affecter les économies réalisées au maintien des
« capacités d’action conventionnelles nécessaires à la logique globale
38 Ce point de vue est contesté par Philippe Wodka-Gallien : « Supprimer la
composante aérienne c’est affaiblir le message de la dissuasion, fissurer
délibérément la stratégie de défense nationale et, par le vide capacitaire ainsi
créé, s’interdire de faire évoluer notre stratégie en fonction de situations futures
inédites » - Voir son article : « Pérennité des forces aériennes stratégiques
françaises » - Revue Défense Nationale, N° 766, janvier 2014
39 Interview de Hervé Morin par Jean Guisnel : « Engageons une marche
collective vers e bannissement de l’arme nucléaire » - Le Point, 18 décembre
2013
40 Voir la tribune libre de Vincent Desportes dans Le Monde du 10 avril
2013 : « L’armée française ne peut intervenir partout. Fixons des zones
d’intervention spécifiques ».
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
23
de la dissuasion »41 Ainsi pourrait-on concilier les exigences d’une
stratégie de l’action pour la gestion des crises internationales et la
préservation de l’ultime recours en cas de menace contre les intérêts
vitaux de la nation. Si le général Desportes aborde de front les
problèmes que soulève l’adaptation de la politique de défense et de
sécurité de la France au nouveau contexte stratégique, il ne semble
pas accorder la même attention au rôle qu’elle pourrait jouer dans la
relance des négociations en vue du désarmement.
Propos final
Les considérations qui précèdent ne permettent pas de spéculer sur
le dépérissement à moyen terme des stratégies nucléaires des
grandes puissances et force est de constater que les risques de
l’élargissement du club atomique se sont accrus depuis la fin de
l’ordre bipolaire. Contrairement à une idée reçue, la fin de
l’antagonisme Est-Ouest et la disparition de la menace soviétique
ne nous ont pas fait entrer dans un monde post-nucléaire mais ont
ouvert une « seconde ère de l’âge atomique » On conçoit donc que
la France à l’instar des autres puissances nucléaires se soucie de
conserver et de moderniser un outil militaire qui garantit la défense
des intérêts vitaux du pays, sauvegarde l’identité nationale,
contribue à la stabilité régionale et permet de se prémunir contre les
incertitudes de l’avenir.
En revanche, l’affichage d’une stratégie de dissuasion nucléaire est
difficilement compatible avec une politique active de nonprolifération
car on ne peut « empêcher l’accession de nouveaux
Etats au cercle nucléaire qui si celui-ci prépare en même temps sa
propre disparition. Comment prétendre interdire aux autres, sauf
renonciation volontaire de leur part, ce que l’on se permet à soimême
».42 Or le caractère discriminatoire du TNP est de plus en
plus vivement ressenti par les Etats non dotés de l’arme nucléaire
qui reprochent aux puissances nanties le non respect de
l’engagement pris en 2000 de tendre vers l’élimination complète de
leurs arsenaux stratégiques. C’est pour dissiper leurs préventions
que le président Obama et des personnalités américaines de haut
41 Voir Vincent Desportes : « L’efficacité de la dissuasion suppose la cohérence
d’ensemble » - Revue Défense Nationale, N°758, mars 2013 et « Les conséquences
opérationnelles et stratégiques de la LPM » - Revue Défense Nationale, N° 764,
novembre 2013
42 C’était la position exposée par le Ministre des Affaires étrangères, Maurice
Couve de Murville dans un discours prononcé le 3 novembre 1964 devant
l’Assemblée nationale.
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
24
rang ont imaginé d’instrumentaliser le thème du global zero mais il
ne semble pas que la campagne menée à la suite de l’appel lancé par
la conférence de Paris, en février 2010, ait produit les effets
escomptés.
Il faut donc s’attendre à des affrontements entre pays nantis et pays
dépourvus lors de la conférence d’examen du TNP de 2015 et l’on
se rendra peut-être à l’évidence que le régime de non-prolifération
institué à la fin des années 1960 n’est plus adapté aux nouvelles
réalités de la vie internationale. On se souvient que le général
Lucien Poirier dont les écrits sur la stratégie théorique font autorité
et qui a notamment exercé sa réflexion sur le devenir des forces
nucléaires après la fin de la guerre froide avait préconisé en matière
de prolifération une approche différente de celle à laquelle on est
accoutumé puisqu’elle tendait à la mise en oeuvre d’une stratégie des
intérêts partagés fondée sur l’émergence d’une « culture nucléaire
universelle ».43 Tout récemment, l’amiral Jean Dufourcq a lui aussi
dénoncé les effets pervers que la lutte contre la prolifération a
introduit dans la « signalétique dissuasive » après la fin de la guerre
froide et mis en question le « culte de la non-prolifération » qui
aurait empêché l’établissement d’un équilibre stratégique stable au
Moyen-Orient.44
Il convient donc de trouver d’autres biais pour garantir la stabilité à
« l’ère de la désorganisation massive » et réfléchir aux conditions de
l’instauration d’un nouvel ordre nucléaire dont la logique serait
différente de celle qui a présidé à la conclusion du traité de non
prolifération.45 En France, l’ouverture d’un débat approfondi sur la
dissuasion et sur son articulation avec la problématique du
désarmement et de la défense européenne s’impose d’autant plus
que la fin de la stratégie nucléaire n’est pas pour demain et que
l’élimination complète des armes nucléaires est hors de portée. Les
observations présentées par Dominique David en conclusion du
dossier sur la dissuasion publié par l’IRSEM46 fixent le cadre d’un
tel débat et pourraient servir d’aiguillon à l’élaboration d’une
43 Lucien Poirier : « La crise des fondements » - Paris, Economica, 1994. Voir la
section intitulée : « Sur le désarmement et la prolifération : la dialectique localglobal
» pp. 101-107
44 Voir son étude : « Les signaux de la dissuasion stratégique » dans le dossier
réalisé par l’IRSEM sous la direction de Jean-Christophe Romer et Thierry
Widemann - Les champs de Mars, N°25, hiver 2013, La Documentation française
45 Voir l’article stimulant de Pierre Hassner : « Régulation et stratégie : l’ère de
la désorganisation massive » - Revue Défense Nationale, N° 758, mars 2013
46 « Dix remarques sur la dissuasion, le nucléaire et la France » par Dominique
David - op. cit., La Documentation française
Défense & Stratégie N°34 – Hiver 2013/2014
25
politique de sécurité coopérative fondée sur la détention d’une
capacité de dissuasion minimale dans un monde où la menace
nucléaire restera latente puisque l’arme nucléaire ne peut pas être
« désinventée ».
*
* *
Ajouter un commentaire